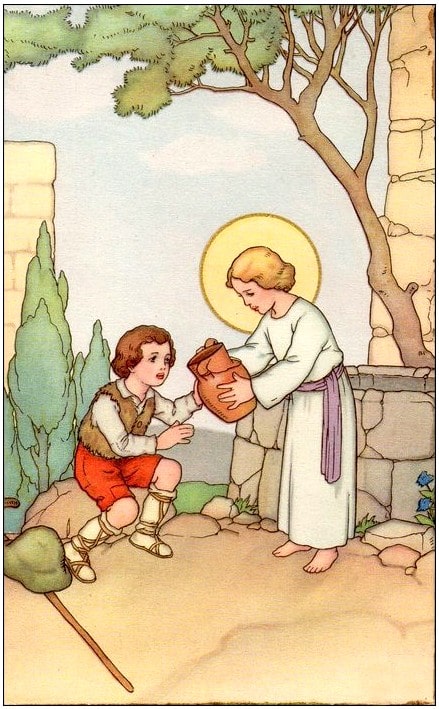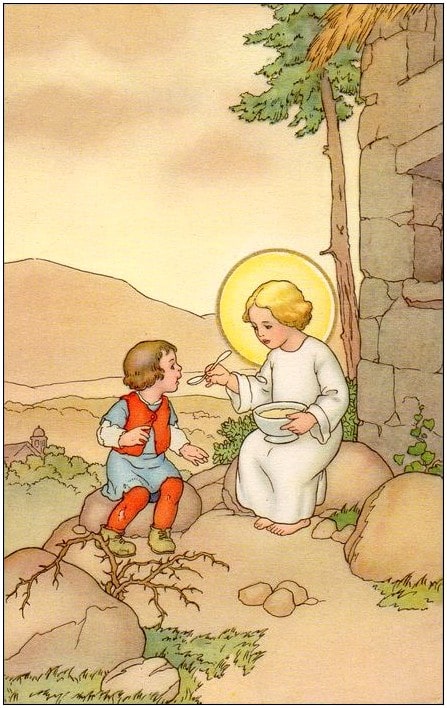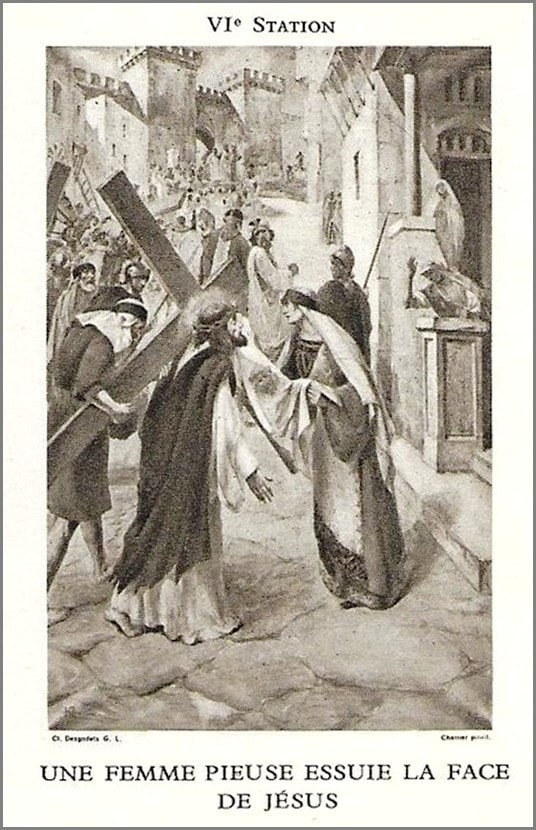Comparaison du statut de la femme païenne et de la femme chrétienne.
1) La femme païenne.
Chez tous les peuples anciens, comme aujourd’hui encore chez tous les peuples non chrétiens, le mari eut un droit excessif dans la famille ; il devint un maître absolu, un despote, un tyran ; il exerça souvent le droit de vie et de mort, non-seulement sur l’enfant, mais quelquefois même sur la femme. Celle-ci, mère de famille, était, ou sous une tutelle permanente, ou prisonnière derrière des enceintes infranchissables, ou traitée comme une esclave, même comme une bête de somme.
Chinois, Indiens, Égyptiens, Grecs, Romains, Arabes, races celtiques et germaniques, sont là pour attester l’ancien droit païen du père de famille. Qu’on examine les mœurs de ces diverses nations, et il en ressort clairement cette vérité : Dans toute l’antiquité, la femme nous apparaît sous le joug de l’esclavage et de la corruption, excepté chez les Juifs, où la femme a toujours eu une dignité inconnue ailleurs.
Chez les Chinois et à l’extrême Orient, la femme reste toujours, comme dans les mœurs turques, avilie et corrompue. Elle est regardée comme un meuble ou un outil, comme une esclave. Voici l’extrait d’une lettre qu’un missionnaire en Chine a écrite à sa sœur, en 1865 : « Ici, la femme ne s’appartient pas à elle-même, elle n’est pas maîtresse de sa détermination et de ses actes ; elle est privée de toute instruction… Ici, on fiance les enfants très-jeunes, souvent même avant l’âge de raison. Pour cet acte si important de la vie, il est très rare que les parents consultent leurs enfants. Or, d’après l’usage du pays, une fille fiancée est une fille vendue, qui n’appartient plus ni à son père, ni à sa mère. Dans les pays païens, la femme est esclave et sans autorité ; une fille ne peut jamais hériter des biens de son père. Les biens des parents passent à leurs garçons, et, à défaut de ceux-ci, à leurs plus proches héritiers, mais jamais aux filles. Ces usages sont tellement enracinés, que, chez nos nouveaux chrétiens, la femme continue à conserver plus ou moins les marques de sa dégradation. Il est vrai que, de loin en loin, nous formons quelques vierges que nous instruisons et à qui nous nous efforçons de rendre leur dignité primitive ; mais ce ne sont là que de rares exceptions, car ce pays est si pauvre qu’une femme, ne pouvant généralement pourvoir à sa subsistance, est presque toujours obligée de se marier pour vivre. Si son premier mari vient à mourir, on la vend à un autre. » […]
Malgré la défense de la civilisation anglaise, on connaît le préjugé encore aujourd’hui en vigueur qui oblige la femme indienne de se brûler toute vive, sur le bûcher de son mari. Dans l’Île de Chypre, à Byblos, à Carthage, comme à Babylone, la femme était forcément dégradée. Chez les Mèdes et les Perses, les Mages et les grands pouvaient épouser jusqu’à leurs mères et leurs filles. Hérodote et Strabon se réunissent pour nous faire la peinture la plus horrible de la polygamie, du concubinage, de l’inceste et du sensualisme domestique, chez tous les peuples orientaux et africains.
Chez les Tartares, les Gaulois, les Germains et les Bretons, la femme était esclave, lorsqu’elle n’était pas guerrière. Elle devait travailler dans les champs ou combattre pour son maître ; à sa mort, comme encore aujourd’hui dans les Indes, elle s’immolait sur son tombeau pour le servir dans l’autre monde.
Chez tous les peuples germains, « la constitution de la famille ne laisse voir que le règne de la force. Dans chaque maison, il n’y a qu’une personne libre, et c’est le chef (Karl) ; point de liberté pour la femme. Fille, elle est, selon l’énergique expression du droit, dans la main de son père ; mariée, dans la main de son mari ; veuve, dans la main de son fils ou de ses proches. Le mariage n’est qu’un marché. »
« A Rome, […] Le chef de famille (pater familiâs), au milieu de la société générale, forme une petite société, soumise à un régime despotique. Ce chef est seul, dans le droit privé, une personne complète, c’est-à-dire, il forme seul un être capable d’avoir ou de devoir des droits. Tous ceux qu’il a sous sa main ne sont que des instruments. Il est propriétaire absolu de tous les biens et même de tous les individus qui composent sa famille. Il a, sous sa puissance immédiate, ses esclaves, ses enfants, sa femme et les hommes libres qui lui sont asservis. »
« La famille romaine n’est pas une famille naturelle, c’est une création du droit civil, du droit de la cité. La femme, épouse pour le mari, mère pour les enfants, peut être étrangère à la famille. Le lien de la famille n’est pas le lien du sang, le lien produit par le mariage et la génération, c’est le lien du droit civil ; la puissance, la force, voilà le fondement de la famille romaine. La tradition légale de la femme, non son consentement, forme l’essence du mariage. »
Aussi, la femme romaine, excepté lorsqu’elle est vestale ou mère de trois enfants, ne sort d’une tyrannie que pour tomber dans une autre. En se mariant, elle reste, lors même qu’elle est émancipée, la chose de son mari comme elle l’était de son père ; elle n’a pas plus de droits qu’elle n’en avait ; elle est au même rang que ses propres enfants. Ce qu’elle apporte, ce qu’elle acquiert par le mariage, tout appartient au mari ; les enfants ne lui appartiennent pas, mais au mari, qui peut les tuer, les exposer, les vendre, les chasser de la famille par émancipation. Quant à elle-même, il peut aussi la chasser, la vendre, et même la tuer. Esclave de quelque côté qu’elle se tourne, elle ne rencontre partout autour d’elle que des maîtres qui, se rappelant comment leurs ancêtres avaient conquis les filles des Sabins, la considèrent toujours comme un butin, et la traitent comme une chose conquise et une propriété vivante. »
Vers la fin de la république, la dissolution des mœurs alla si loin que les maris changèrent de femmes presque tous les ans : ils divorçaient capricieusement. L’empereur Auguste, craignant l’extinction des familles et le dépérissement de la population à Rome, se vit même forcé de mettre des bornes au divorce, d’élargir le cercle de la liberté du mariage entre les différents ordres, de récompenser la fécondité et d’établir des peines contre le veuvage et contre le célibat. Constantin modifia cette loi immorale et Justinien l’abolit.
En résumé, dans le paganisme, le mariage n’est qu’un jeu et la femme qu’un instrument de progéniture qu’on brise arbitrairement. M. Cousin, dans sa préface sur Platon, a bien raison de dire : « Il est certain que l’antiquité avilissait la femme ; avilie, elle perdait ses plus grands charmes. De là, les préférences contre nature qui nous révoltent à bon droit, mais qu’il faut comprendre. Partout où la femme n’est pas, par son âme, l’égale de l’homme, il ne faut pas s’étonner que l’amour, précisément par son instinct le plus pur et le plus élevé, cherche un objet plus digne et s’y attache. Quel homme distingué pouvait livrer son cœur à la femme telle que l’antiquité l’avait faite, partager avec cet être avili, ou stupide, ou frivole, les secrets de son âme, l’associer à sa destinée et y placer l’espérance d’une liaison un peu généreuse ? Cette loi que Platon n’osait faire contre des préférences anti-naturelles, le christianisme l’a établie d’un bout de l’Europe à l’autre, et non-seulement il l’a écrite dans les codes, mais il l’a fait passer dans les mœurs. Sans confondre les devoirs de la femme avec ceux de l’homme, il l’a ennoblie, il en a fait un être moral, capable d’un autre amour que celui des sens, et par-là il l’a soustraite à des préférences qui, n’ayant plus de motif, ont cessé d’elles-mêmes. »
Extrait de : Règne Social du Christ, par l’Abbé Charles Bénard, 1866.